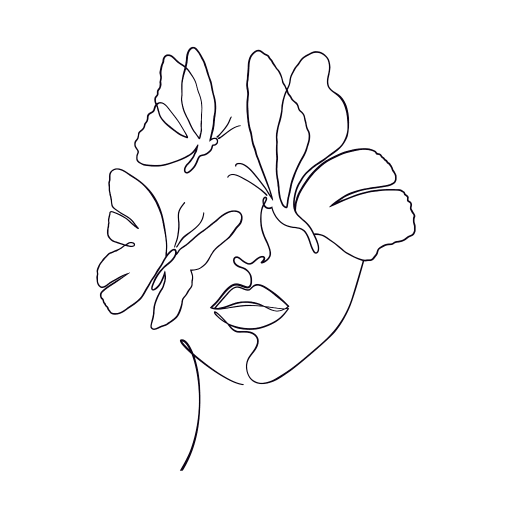Quand une rencontre entre le monde des Avocats et celui du Coaching de vie ouvre de nouveaux horizons… Les Trois Discrètes ont eu l’occasion de rencontrer Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocate au barreau de Lyon au sein du cabinet LOZEN AVOCATS. Spécialisée en droit de la Famille, Maître Anne-Caroline VIBOUREL a partagé ses réflexions autour d’une série de questions relative à la procédure de divorce, tout en nous faisant part des approches complémentaires et bienveillantes qui peuvent être déployées.
1. Quelles sont les étapes clés de la procédure de divorce ?
1. Premier rendez-vous avec l’avocat :
La première étape du divorce commence souvent par un rendez-vous au cabinet de l’avocat, un moment important pour faire connaissance. Beaucoup de personnes arrivent avec de l’appréhension, ne sachant pas à quoi s’attendre. Ce rendez-vous permet à la personne concernée d’exprimer ses émotions, ses besoins matériels et psychologiques, et de faire le point sur sa situation. De son côté, l’avocat-e commence à exposer les bases juridiques du divorce, les différentes options possibles et les étapes à venir.
2. Orientation vers un divorce à l’amiable ou contentieux :
Après cette première rencontre, l’avocat ou l’avocate prend contact avec l’ex-conjoint·e ou son avocat·e (si ce dernier·e en a déjà un·e) pour envisager la possibilité d’un divorce à l’amiable, qui repose sur un accord commun des deux époux·epouses, tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences (enfants, patrimoine, pension alimentaire, etc.).
3. Procédure de divorce à l’amiable :
Si les parties s’accordent pour un divorce à l’amiable, la procédure s’organise de la manière suivante :
- Transmission et analyse des documents fournis par la personne cliente pour identifier les points à régler.
- Négociation de l’accord global sur les conséquences du divorce pour les époux·epouses et les enfants.
- Rédaction et envoi de la convention par lettre recommandée, suivie d’un délai légal de réflexion de 15 jours.
- Signature de la convention après ce délai de réflexion.
- Enregistrement de la convention chez un·e notaire pour officialiser le divorce.
- Transcription sur les registres de l’état civil pour rendre le divorce effectif.
4. Procédure de divorce contentieux :
Si un divorce à l’amiable n’est pas envisageable, il faudra engager une procédure contentieuse devant le juge ou la juge aux affaires familiales :
- Introduction de la demande par l’un·e des époux·epouses pour ouvrir le dossier devant le juge.
- Audience sur les mesures provisoires : le juge ou la juge fixe les mesures qui régiront la vie des époux·epouses pendant la procédure (hébergement, pension alimentaire, etc.).
- Échanges de conclusions : les parties, assistées de leurs avocat·e·s, argumentent tour à tour sur les motifs et conséquences du divorce, jusqu’à ce que chaque aspect ait été examiné.
- Clôture de l’instruction et date de plaidoirie : le juge ou la juge fixe une audience pour les plaidoiries ou pour le dépôt du dossier.
- Délibéré du juge sur le divorce et ses conséquences. La liquidation du régime matrimonial (partage des biens) peut nécessiter une procédure ultérieure si elle n’a pas été résolue dans le cadre du divorce.
5. Décision finale et transcription :
Une fois le divorce prononcé, si aucun appel n’est interjeté, le jugement est transcrit sur les registres de l’état civil, rendant ainsi le divorce officiel.
Cette procédure, qu’elle soit amiable ou contentieuse, se termine donc soit par la signature d’une convention, soit par une décision du juge ou de la juge.
2. Quelles sont les principales différences entre un divorce à l’amiable et un divorce contentieux ?
1. Le divorce à l’amiable : un processus collaboratif
Dans un divorce à l’amiable (ou par consentement mutuel), les époux·epouses sont pleinement acteurs et actrices de leur divorce. Ils·elles doivent parvenir à un accord non seulement sur le principe du divorce mais également sur toutes ses conséquences, qu’elles soient patrimoniales (partage des biens) ou relationnelles (garde des enfants, pension alimentaire, etc.).
- Liquidation du régime matrimonial : avant de finaliser le divorce, les époux·epouses doivent décider du sort des biens en commun, en particulier des biens immobiliers. Cela peut impliquer la vente d’un bien ou le rachat de la part de l’un·e par l’autre.
- Avantages : ce type de divorce permet aux époux·epouses de gérer le rythme des négociations et de trouver des solutions justes, équilibrées et respectueuses des besoins de chacun·e. Les discussions peuvent se faire directement entre eux·elles ou par l’intermédiaire de leurs avocat·e·s.
- Souplesse et respect mutuel : bien accompagné·e·s par les avocat·e·s, le divorce à l’amiable favorise un climat constructif et peut ainsi réduire les tensions et éviter les conflits futurs.
2. Le divorce contentieux : un processus judiciaire
Dans un divorce contentieux, les époux·epouses ne parviennent pas à un accord, et il revient donc au juge ou à la juge de trancher les points de désaccord.
- Rôle du juge : le juge ou la juge aux affaires familiales arbitre les différends en prenant des décisions sur des aspects sensibles (hébergement des enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, etc.).
- Inconvénients : le divorce contentieux est souvent perçu comme une procédure plus lourde et complexe. Elle est plus longue, plus coûteuse, et peut laisser des frustrations ou des points de désaccord non résolus, source de conflits futurs.
- Cas où le divorce contentieux est nécessaire : cette voie peut être incontournable dans les situations où des questions particulièrement sensibles sont en jeu (par exemple, en cas de violences conjugales) ou lorsqu’un divorce sans juge est impossible (par exemple, lorsque l’un·e des époux·epouses est de nationalité étrangère ou réside à l’étranger).
En résumé, le divorce à l’amiable privilégie le dialogue et la coopération, permettant aux époux·epouses de rester maîtres et maîtresses des décisions, tandis que le divorce contentieux fait intervenir le juge comme arbitre des désaccords, dans une approche plus formelle et potentiellement conflictuelle.
3. Quelle est la durée approximative d’un divorce dans notre juridiction ?
1. Pour un divorce à l’amiable
Dans un divorce par consentement mutuel, le délai impératif imposé par la loi est de 15 jours. Il s’agit du délai de réflexion obligatoire qui commence dès que les époux·epouses reçoivent la convention de divorce par lettre recommandée et se termine avant le rendez-vous de signature.
- Durée moyenne en pratique : au-delà de ce délai minimum, la durée d’un divorce à l’amiable dépend de plusieurs facteurs.
- Temps de préparation émotionnelle : le divorce implique un deuil de la relation qui peut nécessiter du temps, selon la durée du mariage, la complexité de la séparation et l’existence de liens (notamment en présence d’enfants).
- Liquidation du régime matrimonial : avant de pouvoir finaliser la convention de divorce, les époux·epouses doivent liquider leur régime matrimonial, ce qui peut être retardé par la vente ou le partage de biens immobiliers.
- Délai estimé : en moyenne, un divorce à l’amiable peut être finalisé en quelques mois, mais ce délai varie beaucoup en fonction de la situation personnelle et patrimoniale des époux·epouses.
2. Pour un divorce contentieux
Le divorce contentieux prend en général plus de temps, souvent plus d’un an, en fonction des spécificités du dossier et de l’encombrement des tribunaux. Cette procédure peut s’étendre sur plusieurs années dans certains cas.
- Éléments allongeant la procédure : un divorce contentieux implique des échanges d’arguments entre avocat·e·s, une audience initiale pour les mesures provisoires, et plusieurs étapes de conclusions avant que le juge ou la juge ne rende son jugement définitif.
- Possibilité d’appel : une fois le jugement de divorce prononcé, chaque partie conserve le droit de faire appel, ce qui prolonge encore la procédure et peut retarder la finalisation du divorce de plusieurs mois, voire années.
En résumé, un divorce à l’amiable peut se conclure en quelques mois, mais un divorce contentieux nécessite généralement plus d’un an et peut s’étirer davantage en fonction de la complexité du dossier et des recours en appel.
4. Quels facteurs peuvent influencer la durée de la procédure ?
Plusieurs facteurs déterminent la durée d’un divorce, certains tenant aux dynamiques relationnelles des parties, d’autres aux aspects matériels et aux contraintes institutionnelles :
- La capacité des ex-conjoints·conjointes à dialoguer et coopérer
La volonté des parties de communiquer et de coopérer est un élément central. Lorsqu’elles parviennent à dialoguer pour trouver des solutions aux questions soulevées par le divorce, comme la résidence des enfants ou le partage des biens, la procédure est plus rapide. Au contraire, l’absence de coopération, la méfiance ou les conflits exacerbés peuvent rallonger significativement les délais, notamment en cas de contentieux.
- Les litiges majeurs concernant les enfants ou le patrimoine
La durée de la procédure est influencée par la complexité des enjeux. Les litiges liés à la résidence des enfants, aux droits de visite, ou aux aspects financiers (comme la prestation compensatoire ou la liquidation du régime matrimonial) sont des points qui, lorsqu’ils restent conflictuels, nécessitent souvent des interventions judiciaires. Des expertises ou des évaluations peuvent également allonger le temps nécessaire pour parvenir à un accord. - Les délais judiciaires : dans le cadre d’un divorce contentieux, les délais de traitement des dossiers par les juridictions jouent un rôle important. L’encombrement des tribunaux et les délais d’audience varient d’un lieu à l’autre et peuvent prolonger le processus, indépendamment de la volonté des personnes impliquées.
- L’importance d’une préparation minutieuse du dossier
Une préparation approfondie permet souvent de gagner du temps. Par exemple, effectuer des simulations de liquidation ou de prestation compensatoire en amont aide à clarifier les options et à orienter les négociations. Objectiver les situations financières et patrimoniales de manière précise et factuelle aide à dépasser les blocages, permettant ainsi aux parties de visualiser une solution commune et d’avancer dans le règlement du divorce.
En somme, la durée d’un divorce dépend fortement de la communication et de la préparation des personnes concernées, de la complexité des enjeux, et de la réactivité des institutions judiciaires.
5. Quel est le moyen de communication privilégié pendant la procédure ?
Communication avec le·la client·e :
J’utilise principalement les échanges par courriel pour structurer les informations et garder une trace écrite de nos échanges, essentielle pour un suivi rigoureux du dossier. Pour les questions spécifiques ou les points d’étape, le·la client·e peut également programmer des rendez-vous téléphoniques directement via un lien menant à mon agenda en ligne. Enfin, pour les sujets nécessitant un échange approfondi, je propose des rendez-vous en personne pour répondre aux préoccupations du·de la client·e de manière complète et personnalisée.
Communication avec le·la confrère et entre les époux :
Lorsque le contexte le permet et que les échanges entre les ex-conjoints sont possibles, j’encourage les réunions dites “à quatre” : une rencontre réunissant les deux ex-partenaires et leurs avocat·e·s respectif·ve·s. Ce format offre un cadre sécurisé où les personnes concernées peuvent aborder les points sensibles, chercher des solutions communes, et dialoguer de manière constructive. Cette approche favorise la recherche d’un accord global et durable, en créant un espace d’écoute et de respect mutuel.
6. À quelle fréquence sont effectuées des mises à jour sur le dossier ?
J’informe mes client·e·s en temps réel des avancées de leur dossier dès qu’un nouvel élément se présente : par exemple, lorsque le·la confrère répond, quand des documents ou informations supplémentaires sont transmis·es, ou lorsque l’audience approche et que certains éléments doivent être actualisés.
Je propose aussi régulièrement des points d’étape pour les client·e·s qui le souhaitent, même si le dossier n’a pas évolué récemment, permettant ainsi de maintenir une continuité dans l’accompagnement, d’adresser d’éventuelles questions ou inquiétudes, et de rassurer mes client·e·s tout au long du processus.
7. Quels facteurs influencent les décisions concernant la garde et la pension alimentaire ?
Les décisions concernant la résidence de l’enfant et la pension alimentaire sont guidées avant tout par son intérêt supérieur, centré sur son bien-être, sa stabilité, et un environnement sécurisant.
Pour la résidence, plusieurs facteurs sont pris en compte. Elle peut être fixée de manière principale chez l’un·e des parents ou en alternance entre leurs domiciles, sans que cette alternance doive forcément être égalitaire. Elle peut suivre différents rythmes (une semaine sur deux, 15 jours/15 jours, ou des schémas plus fractionnés comme le 2/2/3). Les critères incluent des aspects matériels, comme l’éloignement géographique entre les domiciles des parents, et des éléments plus subjectifs, tels que l’âge de l’enfant, les habitudes familiales déjà en place, et la capacité de chaque parent à répondre de façon cohérente aux besoins quotidiens et affectifs de l’enfant.
Concernant la pension alimentaire, elle est fixée en fonction des besoins spécifiques de l’enfant et des ressources de chacun·e des parents. Un simulateur de pension alimentaire peut fournir une estimation indicative, mais la décision repose sur une appréciation concrète qui tient compte du niveau de vie des parents, des dépenses passées pour l’enfant, et de tout autre élément pertinent pour garantir sa sécurité matérielle et affective.
En résumé, l’objectif des décisions de garde et de pension est de préserver pour l’enfant une continuité affective et matérielle dans un cadre lui permettant de s’épanouir en toute sérénité.
8. Quelles sont les erreurs courantes que les personnes commettent pendant le processus de divorce ? Comment éviter ces erreurs ?
Pendant un divorce, l’une des difficultés (je ne dirais pas erreur) les plus importantes est de se laisser envahir par des émotions intenses comme la colère, la tristesse ou la frustration. Ces sentiments, bien que légitimes, peuvent brouiller les priorités et nuire à la capacité de prendre des décisions éclairées. Un autre écueil courant est de percevoir le divorce comme un combat. Cette vision conflictuelle conduit souvent à une dynamique d’opposition, où l’objectif devient de « gagner » contre l’autre, plutôt que de trouver des solutions équilibrées et respectueuses des intérêts de chacun·e.
Il est essentiel de rappeler que les enfants ne souffrent pas de la séparation en elle-même, mais plutôt de l’exposition à un conflit intense et prolongé entre leurs parents. Pour leur bien-être comme pour le vôtre, il est préférable d’adopter une approche de coopération et de chercher une transformation positive de la relation plutôt que de rester dans une logique d’affrontement.
Enfin, il est également fréquent d’idéaliser la situation passée ou de rejeter tout le passé en bloc. Or, en valorisant ce qui a été partagé de positif, même si l’union touche à sa fin, les ex-partenaires peuvent se tourner vers l’avenir avec respect mutuel et dignité. Cela favorise une relation de co-parentalité, dans laquelle chacun·e se sent légitime et digne de confiance, ce qui est essentiel pour la stabilité des enfants.
Pour éviter ces erreurs, il est recommandé de :
- Prendre du recul émotionnel : Si nécessaire, un accompagnement thérapeutique ou un coaching peut aider à mieux gérer ses émotions.
- Adopter une perspective à long terme : Garder en tête l’impact des décisions sur la relation future, surtout pour les enfants.
- Valoriser la coopération : Considérer le divorce comme une transition plutôt que comme un échec, et s’engager dans un processus de communication respectueuse avec l’ex-partenaire.
9. Qu’entendez-vous par « négociation raisonnée » et comment la mettez-vous en œuvre lors du premier rendez-vous ?
La négociation raisonnée est une méthode de résolution des différends qui vise à dépasser la logique des positions figées et des compromis, pour se concentrer sur les intérêts et les besoins réels des personnes concernées. Plutôt que de se limiter aux revendications immédiates de chacun·e, cette approche cherche à définir la problématique de manière objective, à comprendre les motivations sous-jacentes, et à identifier des solutions qui répondent au mieux aux intérêts communs.
Lors du premier rendez-vous, la mise en œuvre de cette méthode commence par une écoute active et bienveillante. L’objectif est de comprendre les besoins et les valeurs qui se cachent derrière les demandes exprimées. Par exemple, si une personne exprime une demande élevée de prestation compensatoire, il peut s’avérer que son besoin réel soit davantage axé sur la sécurité financière ou la reconnaissance de sa contribution passée. Dans ce cas, il s’agit d’explorer avec elle différentes options pour répondre à ces besoins de façon créative, et non de se limiter à la seule dimension monétaire.
Ainsi, dès le début, j’aide chaque partie à identifier et formuler ses intérêts profonds, en ouvrant le champ des possibles sans se figer sur des positions initiales. La négociation raisonnée permet ainsi d’aborder la situation de façon constructive, en favorisant la collaboration pour trouver des solutions durables et équilibrées. Les positions sont souvent négociables ; les besoins fondamentaux, eux, doivent être entendus et pris en compte.
10. Quelles sont les principales techniques que vous utilisez pour amener les parties à trouver elles-mêmes la solution à leur litige ?
Dans ma pratique d’avocat·e, je suis souvent amené·e à utiliser les outils du·de la médiateur·rice : écoute active, reformulation, identification des émotions et des besoins, communication non-violente, négociation raisonnée… Ces outils permettent à chacun·e de clarifier ce qui est essentiel pour elle ou lui. Avant de formuler des demandes à l’autre, il est absolument nécessaire de clarifier ses besoins et d’identifier plusieurs options envisageables pour nourrir ses besoins.
Bien sûr, j’accompagne mes client·e·s pour identifier des options juridiquement acceptables et préserver leurs intérêts, mais je ne décide pas à leur place de ce qui est bon pour eux.
11. Comment avez-vous l’assurance que la médiation est adaptée au litige et qu’elle correspond bien aux attentes des parties prenantes ?
La médiation repose sur des principes fondamentaux de liberté et de responsabilité. Les parties doivent être libres d’entrer et de sortir du processus, et capables de prendre des décisions en toute autonomie. C’est pourquoi, lorsqu’il existe des situations d’emprise ou de violences qui limitent la capacité d’une personne à agir librement, la médiation n’est pas adaptée.
La médiation est idéale lorsque les parties souhaitent non seulement résoudre leur différend, mais également maintenir un lien de respect ou de coopération. Si l’une de ces deux conditions fait défaut — l’envie de trouver une solution ou celle de préserver un lien — alors la médiation n’est pas la meilleure voie.
12. Quelles sont, selon vous, les mesures à mettre en place pour que l’avocat·e devienne « un·e conseiller·e naturel·le » dans tous les domaines de la vie quotidienne ?
Actuellement, l’avocat·e est souvent sollicité·e pour éteindre des “incendies” juridiques, en intervenant lorsqu’un conflit est déjà bien installé. Pour renforcer les liens familiaux et prévenir les tensions, il serait bénéfique que l’avocat·e accompagne les familles bien en amont, en prenant un rôle de conseiller·e dès les premières étapes de la vie commune.
Concrètement, cela pourrait se traduire par :
- Des consultations préventives individuelles ou de couple : pour explorer les implications de différentes formes d’union, d’exercice de l’autorité parentale, d’adoption, ainsi que les conséquences patrimoniales, fiscales et successorales d’un engagement.
- Des médiations familiales d’anticipation : pour accompagner les projets familiaux et renforcer la communication avant que les conflits ne surgissent.
- La création d’un réseau interprofessionnel : afin de promouvoir une approche de droit préventif et d’offrir un accompagnement global, en synergie avec des professionnel·le·s du bien-être et de la relation.
- L’élaboration de “contrats pour rester ensemble” : une innovation qui offre aux couples un cadre structurant pour organiser leur vie commune. Ce contrat permet de poser les bases de leur union en anticipant les éventuelles difficultés et en définissant des principes de coopération.
🎯 Objectif : Ces initiatives visent à offrir aux couples et familles un cadre de vie commun plus stable, où la communication, la planification et la prise de décisions sont encouragées en amont. En agissant ainsi, l’avocat·e contribue à créer un environnement familial plus serein et harmonieux, tout en prévenant les conflits.
Pour devenir un·e véritable “conseiller·e naturel·le”, l’avocat·e doit être plus qu’un·e expert·e juridique : il·elle doit incarner un·e partenaire à l’écoute, impliqué·e dans les réalités quotidiennes de ses client·e·s, et prêt·e à collaborer avec d’autres professionnel·le·s pour offrir un accompagnement complet et personnalisé.
13. Quelle est pour vous l’obligation déontologique la plus importante ?
L’obligation de confidentialité est fondamentale : c’est la pierre angulaire qui permet d’établir un climat de confiance et de sécurité. Elle garantit à mes client·e·s la liberté de s’exprimer pleinement, sans crainte que leurs confidences soient révélées ou utilisées contre eux·elles. Grâce à cette confidentialité, ils·elles peuvent partager leurs préoccupations les plus intimes, en sachant que tout reste strictement entre nous.
Cette obligation va également au-delà de la relation client·e-avocat·e. Elle assure un cadre de sécurité dans nos échanges entre confrères et consœurs, permettant des discussions constructives et amiables sans crainte de voir les informations partagées être exploitées par la suite en procédure judiciaire. En somme, la confidentialité est essentielle pour préserver l’intégrité de la relation avocat·e et la qualité des discussions, pour le bien de toutes les parties impliquées.